|
Sâgigsisimârnapok
(*)
(*) « ce qui vous donne
un beau visage » en langue inouit
Un
jour, la mort de mon père devint proche.
(…) Mon père regarda dans la direction
du sud, et il aperçut la mort. Elle entrait
dans la maison suivie d’une foule de personnages
habillés de feu, innombrables, et dont
la bouche lançait de la fumée
et du soufre.
Les yeux de mon père avaient peur et
ils versaient des larmes. En ce moment là
son âme se détacha en poussant
un grand soupir, tandis qu’elle cherchait
un moyen de se cacher.
Lorsque j’ai vu, au gémissement
de mon père, qu’il avait aperçu
des puissances qu’il n’avait encore
jamais aperçues, je me levai et menaçai
la mort. Elle prit peur.
Lorsque mon père eu rendu l’esprit
je l’embrassai. Je pensai : O Dieu, où
sont maintenant tous les travaux de métier
qu’il a faits depuis son enfance jusqu’à
maintenant ? Ils ont tous passé en un
seul moment. C’est comme s’il n’était
jamais né en ce monde.
(évangiles apocryphes
de la nativité et de l’enfance,
Histoire de Joseph le charpentier, extrait de
l’adaptation théâtrale)
L’adaptation
theatrale
Que viennent faire les évangiles
apocryphes de la nativité dans l’histoire
d’un jeune eskimo ? L’enfance de
Jésus ne s’oppose pas à
celle d’Agojaraq ; les personnages qui
participent à l’éducation
de ces deux enfants se complètent. Les
uns sont simplement humains, les autres ont
une portée symbolique. Comme le destin
de ces deux enfants : au terme de son enfance
heureuse, Agojaraq part découvrir le
monde ; Jésus lui, se met en route pour
le sauver. Peu importe qu’il y soit parvenu
ou non.
|
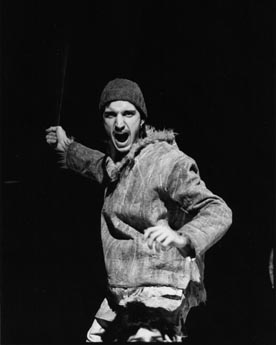
 © Mercedes Riedy
© Mercedes Riedy
|
Presse – extraits
24Heures, février
2003, Corinne Jaquiéry
Le ton est vif, joyeux, les phrases volent, rapides
et légères, la jubilation est palpable.
En répétition, les sept comédiens
de Sagigsisimârnapok sont gagnés par
l’atmosphère allègre qui se dégage
d’un texte empreint de merveilleux, de malice
et de poésie.
(…)
Après Lettres à son frère Théo,
de Vincent Van Gogh et Pour solde de tout compte,
deux créations remarquées pour leur
force et leur sensibilité, le metteur en scène
lausannois, père d’un petit garçon
de 6 ans, a donc éprouvé la nécessité
de continuer de s’exprimer sous la forme du
témoignage d’une histoire de vie, avec
l’envie de parler de famille et d’éducation.
Il a aimé, dans le récit de Jörn
Riel, « l’idée d’une communauté
d’adultes responsables et concernés par
le devenir de leur enfant qui s’appliquent sereinement,
de manière critique et clairvoyante, à
leur fournir les moyens de faire leur travail d’enfant
: témoigner de la vie »
Pour Georges Brasey, parler souvent péjorativement
de famille éclatée, comme s’il
n’y avait qu’un seu exemple familial,
est absurde. « Dans l’histoire de Sagigsisimârnapok,
il y a cinq pères et deux femmes, et tous ont
un respect infini, un respect peu banal de ce qu’est
un enfant. Ce qui est passionnant, c’est aussi
que ces gens qui vivent ensemble dans un tout petit
espace parviennent à s’entendre malgré
leurs différences. Ici, la différence
permet de se situer et de renvoyer à ses propres
limites et à ce que nous sommes »

Le Temps, février
2003, Anna Holer
(…)Sagigsisimârnapok, mis en scène
par Georges Brasey, ne fait pas rire, ni même
sourire. Et les visages, à la sortie de la
salle, sont comme fanés. De déception.
Pourtant, l’histoire que nous racontent les
comédiens envoûte. Agojaraq, un jeune
métis eskimo, témogne de son enfance
dans le nord canadien. Il vit dans une « maison
de paix », représentée sur scène
par des traîneaux de bois sur un énorme
drap blanc gonflé d’air. « Une
maison avec une jolie voix et une odeur familière,
un temple e l’amitié »
(…)
Dans ce foyer règne le bonheur. Un bonheur
léger et fragile. Parce qu’après
deux pièces belles et noires, Lettres à
son frère Théo, d’après
Vincent Van Gogh et Pour solde de tout compte, inspiré
du récit d’une prostituée suisse
romande, Georges Brasey a eu envie de parler de bonheur.
Seulement, il ne passe pas la rampe. La pièce
se termine au moment où l’on a juste
fini de planter le décor. Le montage des textes
est peu clair, et le personnage de Marie tombe comme
un cheveu sur la soupe. Les comédiens oscillent
entre un émerveillement affiché et le
burlesque, ce qui étouffe toute poésie.
Le ton juste, celui qui nous aurait donné un
beau visage, est loin.

Le Courrier,
février 2003
On connaît Georges Brasey pour son précédent
Pour solde de tout compte témoignage bouleversant
des horreurs de la prostitution, et spectacle qui
a durablement marqué les esprits. Il revient
aujourd’hui avec un théâtre à
la forme sensiblement similaire – il s’agit
toujours de rendre compte d’un témoignage
– mais malheureusement moins convaincante. Amoureux
d’une parole organique qui circule entre la
scène et la salle et les surplombe toutes deux,
Georges Brasey dirige ses acteurs comme des porte-langue.
On regrettera dès lors que, dans Sagigsisimârnapok,
ceux-ci cèdent si souvent à l’incarnation,
voire au surjeu. Le projet n’en reste pas moins
intéressant, puisqu’il s’agit de
montrer un parcours de vie heureux grâce au
modèle social communautaire. Un spectacle en
dents de scie, donc.
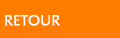
|